Coupoles Dominique BARTHÉLEMY : « L’erreur dans les études historiques sur l’an mil »
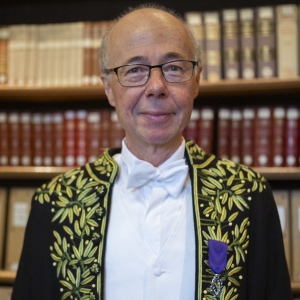
Les terreurs de l’an mil ont fait fureur en France entre 1830 et 1870, au cœur d’un XIXe siècle romantique et souvent anticlérical. Michelet a voulu faire sentir, en une page vibrante, comment le peuple était épuisé de misères et d’oppressions, impressionné et frappé par des dérèglements climatiques et par les famines et les épidémies qui s’ensuivaient, tel le mal des ardents en 994 : ainsi les serfs désespérés et les seigneurs saisis par la crainte du Jugement tout proche se donnaient ou donnaient leurs terres à l’Église. Pour Eugène Suë et beaucoup d’autres, celle-ci, l’Église, s’est rendue coupable d’une mystification crapuleuse : tandis que l’épouvante régnait au-dehors, les moines faisaient bombance et faisaient l’amour en s’exclamant « -Rions des sots, nargue des crédules ! » Puis la fin du monde ne vint pas, de sorte que les terres restèrent aux moines. Dans la France profonde, sous la troisième république, celle légende demeurait vivace, sous une forme ou sous une autre.
Elle a suscité en retour des réfutations puissantes de la part de l’école méthodique, entre 1873 et 1947, de Dom François Plaine à Ferdinand Lot, et aussi bien par des historiens proches du clergé que par des anticléricaux soucieux de combattre toutes les erreurs. Et cependant cette école méthodique, depuis un demi-siècle, sert souvent de repoussoir, et il paraît de bon ton de se démarquer le « l’école anti-terreurs », de tenir à distance ces réfutations pour redonner vie à un an mil « millénariste ».
Est-ce que pourtant la critique incantatoire contre l’école méthodique, brocardée sous le nom de « positivisme », telle qu’on la pratique aujourd’hui dans les séminaires à la mode n’aurait pas quelques inconvénients ?
Nous n’avons peut-être pas toutes les sources qu’il faudrait pour bien mesurer et analyser les craintes ou attentes de fin des temps et les mouvements sociaux et religieux, autour de l’an 1000 ou 1033. Notre connaissance repose sur une documentation encore très clairsemée, souvent elliptique ou ambiguë : ainsi lorsque les chroniques monastiques relèvent des faits étranges ou catastrophiques ou font allusion à l’Antéchrist ou lorsque les préambules de chartes portent que la fin du monde approche. Cette documentation toutefois est assez étoffée pour montrer que l’eschatologie n’est pas omniprésente et, d’autre part, elle nous procure quelques clés en vue de son décryptage même.
La réfutation de l’école méthodique, fruit d’une expertise, présente trois arguments très forts. D’abord tout suggère que peu de gens se savaient en l’an 1000 de l’Incarnation, l’usage des dates de l’ère chrétienne étant très limité, même dans les milieux ecclésiastiques. Les paysans devaient se soucier de leurs récoltes, donc de leur survie concrète, non d’une date abstraite hors du temps cyclique de leur vie et de la liturgie annuelle. Ensuite, deuxième argument, les autorités ecclésiastiques n’ont pas annoncé la fin des temps pour une date précise : elles refusaient notamment de prendre au sens littéral les mille ans du chapitre 20 de l’Apocalypse (après mille ans une libération de Satan et une deuxième résurrection dont le sens exact n’est pas limpide). Enfin, troisième argument, il ne nous est parvenu aucun texte contemporain attestant expressément d’une grande émotion collective qu’aurait provoquée l’approche de l’an 1000 de l’Incarnation ou de l’an 1000 de la Passion du Christ (donc de 1033). L’erreur, appuyée sur une interpolation du XIIe siècle, remonte à un texte du XVe siècle. Et depuis lors, il a toujours fallu écrire entre les lignes des chartes ou des récits pour introduire une grande terreur, un grand espoir ou, comme Michelet, un mélange des deux.
Sans doute aucun des principaux arguments de l’école méthodique n’est-il à lui seul absolument décisif, puisqu’après tout l’an mil n’est pas passé totalement inaperçu : un Raoul Glaber surtout, moine de haute culture, était sensible, à sa manière, aux dates millénaires de 1000 et 1033. D’autre part, les religieux ont pu ne pas tous bien comprendre la lecture officielle de l’Apocalypse et bien diffuser le message de prudence. Enfin, certains textes auraient pu être perdus. Toutefois la conjonction des trois grands arguments de l’école méthodique est particulièrement défavorable aux prétendues terreurs de l’an 1000, et la critique de cette légende s’est imposée parmi les historiens professionnels. Ils ont tous remarqué que les préambules de chartes évoquant la fin du monde, mais sans lui fixer aucune date, étaient reproduits tels quels entre 600 et 1100, et toujours très minoritaires. Ils ont relevé dans les dossiers d’entre 1000 et 1033 beaucoup de signes de dynamisme, telle la confection d’un manteau de blanches églises sur le monde chrétien. Edmond Pognon, en 1947, en préface à un beau recueil de traductions des textes, pensait que le lecteur attentif cesserait de croire à la légende : « la meilleure manière de mettre l’erreur en fuite », demandait-il, « ne serait-ce pas d’exhiber ingénument la vérité ? ». Ce qui ne l’empêchait pas, un peu plus loin, de souligner que l’erreur a des ailes (celles de l’imagination et de la hâte), alors que la vérité se trouve « au fond du puits », il faut faire l’effort d’aller la chercher. Au même moment (1947), tout en reprenant avec brio l’argumentaire contre le mythe des terreurs de l’an mil, Ferdinand Lot concluait en prévoyant que ce mythe ne serait pas « définitivement détruit ». En effet, notait-il, un rien désabusé, « l’erreur ne périt jamais quand elle excite l’imagination et prête à des développements littéraires, ou encore quand elle flatte des préjugés religieux ou anti-religieux. En dépit des historiens, l’erreur repousse comme le chardon et le chiendent ».
Il avait raison, le retour des terreurs réfutées ne tarda point. Cependant elles ont réapparu dans les livres d’universitaires eux-mêmes, en partie du fait des lacunes de la critique méthodique, et elles ont subi une métamorphose. C’est dès 1952 que l’historien d’art Henri Focillon se démarque de la réfutation dite « positiviste » dans son An mille. Focillon argumente sur les images saisissantes d’un commentaire de l’Apocalypse : le Beatus de Saint-Sever. Il les rapproche des figures fantastiques de l’art roman et il pense que déjà les blanches églises de l’an mille étaient comme une Bible des simples, que les fidèles en les regardant s’imprégnaient d’un message eschatologique. De la sorte, à défaut de se focaliser sur une ou deux dates précises, ce serait toute une époque, faut-il dire un siècle de l’an 1000, qui aurait vécu dans une « inquiétude diffuse ». Une faiblesse de la critique positiviste était en effet d’avoir récusé comme trop distants des dates fatidiques des éléments du milieu du Xe siècle : le traité sur l’Antéchrist d’Adson de Montiérender (950/954), et surtout la prédication à Paris d’une fin des temps pour 1000 réfutée vers 960, sur l’ordre de son abbé, par le jeune Abbon de Fleury, qui devenu vieux en reparle en 996, certes sans insister et comme d’une erreur parmi d’autres, mais comme d’une erreur dont il faudrait encore se garder
Dans la foulée, un autre grand historien, Georges Duby, parle en 1967 d’inquiétudes diffuses, et même d’une « pulsion mystérieuse » qui aurait poussé les pèlerins vers Jérusalem en 1033 et il évoque en 1978, « l’attente exaltée », dès 1024, du millénaire de la Passion, chez les participants à des conciles de paix. Tout en restant prudent, Georges Duby réintroduisait donc les dates précises (mais plutôt la seconde : 1033) : à vrai dire il n’y insistait pas trop, mais tout de même il ouvrait la voie à l’invention, par des francs-tireurs, d’un nouvel an mil, marqué non plus la crainte du Jugement dernier en 1000, mais par l’espoir d’un millenium de justice et de paix à partir de 1033, un espoir confus mais vif et un espoir bientôt déçu, qui mobiliserait les foules dans les conciles de paix, après la famine de 1031-1032. Jean-Pierre Poly en 1996 raille la critique méthodique de la vieille légende : « ignorant » écrit-il, « que les terreurs de l’an mil étaient une invention romantique, les gens de Sens se mirent à millénariser ». En réalité les pages de Raoul Glaber qu’il exploite abusivement ne parlent que de la découverte du bâton de Moïse, donc d’un symbole du pouvoir sacerdotal, et de la dynamique miraculeuse classique qui s’ensuit, avec des guérisons de pèlerins. Un autre électron libre, Richard Landes, développe une théorie du complot contre un millénarisme caché !
Tout cela ressemble par instants à une crise des années 1990, à un dérèglement historiographique de l’an 2000. L’antipositivisme primaire, qui sévissait alors, parait avoir autorisé que l’on s’affranchisse parfois trop des règles de la méthode comme si elles n’étaient que des contraintes désuètes. Sans doute la plupart des historiens, exemplaires de probité, demeurent-ils soucieux de bonne méthode et en quête de vérité, mais peu d’entre eux se risquent à des réfutations, qui exigent de difficiles dosages entre le respect envers autrui et la nécessité d’être clair. Pourtant les réfutations ne sont-elles pas d’autant plus indispensables que les historiens prétendent désormais valider leurs thèses par « le consentement des pairs », à l’instar de ce qui se fait dans les sciences dures, mais après un examen critique, après un vrai débat ?
Nous n’avons été qu’une poignée à oser la critique constructive du nouvel an mil, à opposer aux dérives les plus nettes ce que Reinhard Koselleck appelle « le veto des sources », là où il est incontournable. Pour autant, j’espère que nous avons évité les étroitesses et certaines assurances trop péremptoires du vieux « positivisme ». Il a été nécessaire, face à Raoul Glaber, de se montrer plus attentifs à ce qu’il avait écrit, d’éviter un certain « négativisme » des « positivistes » d’autrefois qui le dépréciaient du fait de ses diverses erreurs factuelles. Car l’an mil pour eux, à défaut d’avoir connu de grandes terreurs, était une époque de grandes erreurs des chroniques ! Pourtant la vision propre à Raoul Glaber, ses exagérations, ses interprétations documentent un réel effort de l’Église, alternativement inquiétante et rassurante : il a bien relaté des terreurs (et il emploie le mot), mais celles causées par la crainte des mauvaises récoltes, des terreurs tenues pour des punitions divines en vue d’obliger les chrétiens, clergé en tête, à se réformer, dans l’esprit du Deutéronome. Donc non pas des terreurs de l’an mil, mais des terreurs en l’an mil, comme à d’autres époques! Encore Raoul Glaber avoue-t-il en passant que le peuple chrétien, en 1031-1032, ne prenait pas assez garde aux coups paternels de Dieu.
L’aventure de cette réfutation des erreurs de l’an 2000 peut aujourd’hui intéresser, car nous sommes confrontés de plus en plus aux légendes de toutes sortes fleurissant sur la toile, aux désinformations. L’héritage de l’école méthodique doit être à la fois assumé, enrichi et infléchi.
Nous pouvons enrichir l’argumentaire « anti-terreurs » de 1900, par la critique des projections. Jean Delumeau a évoqué la projection des peurs eschatologiques collectives de l’Occident du XVe siècle sur un Xe siècle qui ne les avait pas connues forcément à ce point, dont l’Antéchrist n’avait pas toute la puissance de celui de l’âge classique, étudié par Jean-Robert Armogathe. Plus près de nous, l’évolution récente de la religion y diminue la crainte du Jugement et y accentue l’élan vers la justice et la paix sociales : les nouvelles affabulations sur l’an mil portent la marque de l’an 2000. À cette critique des projections peut s’ajouter désormais une critique des paradigmes de l’historien, comme de celui d’une violence féodale débridée suscitant une obsession apocalyptique : ces paradigmes peuvent lui faire voir dans ses sources ce qui n’y est pas et lui faire manquer ce qui s’y trouve, et il ne s’en débarrasse pas facilement. Car enfin, la vérité ne se laisse pas mettre toute nue aussi volontiers que le pensait Edmond Pognon !
L’héritage de l’école méthodique peut aussi être infléchi dans un sens plus nuancé. Nous nous contenterons parfois d’une distinction entre le certain et l’incertain, ou entre le connu et l’inconnu, tout en ne nous refusant pas à trancher entre la vérité et l’erreur chaque fois que c’est possible. Prononçons-nous donc, un ton plus bas que l’école méthodique et selon l’expression des médecins, « en faveur » d’une religion de l’an 1000 adonnée à la régulation sociale et plutôt surprenante, à tout prendre, par une certaine faiblesse de l’eschatologie collective que par sa force. Excluons les mouvements de masse mais prenons bien en compte, dans les milieux lettrés entre 900 et 1100, les messages de vigilance à moyen terme quant au jour du Jugement et : des messages pas tous clairs, escortant parfois une polémique. Ainsi Bernard d’Angers traite-t-il d’antichrist un chevalier qui insultait la statue de sainte Foy dans le feu d’un conflit de propriété : le mot parait ici plus prétentieux qu’incandescent. Pour l’essentiel, les éléments de langage tirés de l’eschatologie, légués par la culture carolingienne, servent dans des polémiques en faveur de la réforme disciplinaire et de la propriété des églises, avec une appréhension de la fin des temps à moyen terme, comme de juste. L’appellation d’antichrist convient particulièrement pour frapper alternativement un pape indigne et des réformateurs trop radicaux, dénoncés comme étant des séducteurs hypocrites. Autant de précurseurs d’un Antéchrist dont l’heure n’est pas encore tout à fait venue.
Je me prononcerais aussi, comme Sylvain Gouguenheim, « en faveur » d’une relativisation de l’entrefilet d’Abbon de Fleury (en date de 996). Après tout, étant donné qu’il y a le chapitre 20 de l’Apocalypse, d’interprétation délicate, ne serait-il pas presque étrange que nul religieux lettré ou demi-lettré n’ait pensé à la fin des temps pour 1000 ? Mais sans pour autant avoir un impact important.
Parmi les erreurs de toutes sortes qui encombrent la bibliographie récente, quelques-unes ont pu ouvrir de nouvelles pistes, directement ou à l’occasion des efforts accomplis pour les réfuter. Mais d’autres ont empêché ou retardé d’utiles enquêtes et ont produit un brouillage : si l’an 1900 avait été trop sévère, l’an 2000 semble avoir été trop laxiste. Et notre académie me paraît avoir vocation à ranimer une certaine crainte de l’erreur - sans aller pour autant jusqu’à semer la terreur…

