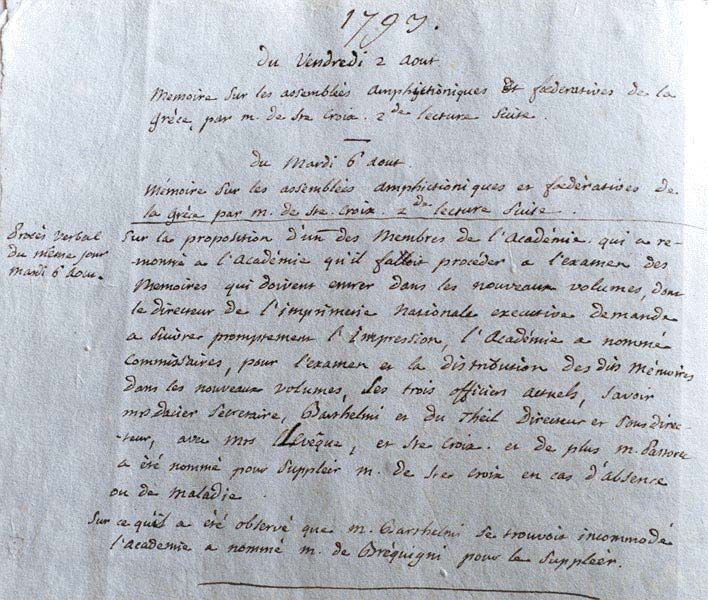Histoire 1793 – 1816
De la suppression à la Renaissance
Le 8 août 1793, par un décret bref comme un couperet, la Convention supprimait « toutes les académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la Nation » (article I). C’était un coup mortel porté aux académies royales, déjà affaiblies par le décret du 27 novembre 1792 leur interdisant de veiller au remplacement des académiciens décédés – à la seule exception de l’Académie des Sciences. Seulement, si en son article Ier le décret d’août 1793 tirait un trait, il ne marquait nullement un point final ; son article III, qui avait la marque de l’« abbé » Grégoire, évêque constitutionnel du Loir-et-Cher, prévoyait en effet le remplacement des académies par « une société destinée à l’avancement des sciences et des arts », dont le Comité de l’Instruction publique devait dresser le plan. Selon la phraséologie de l’époque, on entendait substituer à l’ancien corps un nouveau qui en conserverait les vertus sans les défauts – i. e. tout ce qui se rapportait à l’Ancien Régime. Les difficultés de la Terreur différèrent ce projet et il fallut attendre le 22 août 1795 et la Constitution de l’an III pour que soit décidée la création d’un « Institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts » (article 298).
Suivant un rapport de Daunou, la veille du jour où la Convention devait se séparer, fut votée la loi organique du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) dont le titre IV créait un Institut national des sciences et des arts, composé de 144 membres répartis en trois classes (Sciences physiques et mathématiques, Sciences morales et politiques, Littérature et Beaux-Arts). Chaque classe élisait son Bureau et disposait d’un lieu de réunion ; mais, et c’est la grande innovation, elles formaient un tout unique : les membres avaient indistinctement même titre, mêmes droits, mêmes honneurs, même indemnité. Ainsi se répétait dans l’ordre intellectuel l’idéal politique de la République une et indivisible ; selon une jolie formule de Daunou, c’était créer « une encyclopédie vivante » où le commerce des savoirs les plus divers, mais aussi leur enseignement, pourraient rendre possibles tous les progrès. Favoriser les relations entre les disciplines, unifier les savoirs, tout cela était certes intellectuellement stimulant ; mais mettre en pratique, dans un cadre administratif rigide, de telles aspirations, travailler en commun, c’était relever un tout autre défi ; mais celui-là risquait d’être perdu d’avance, comme on put l’augurer à l’occasion de la séance d’ouverture solennelle de l’Institut, le 4 avril 1796, au palais du Louvre. Rappelons ici brièvement les temps forts de cette cérémonie qui ne laisse de surprendre par son déroulement quasi surréaliste : après plusieurs discours au style pompeux et une dissertation de Daunou sur la destination de l’Institut, ses devoirs et ses droits à l’égard du gouvernement, le poète officiel Collin d’Harleville déclama une pièce de vers interminable intitulée fort à propos : La grande Famille réunie ; l’assistance fut alors gagnée insensiblement par l’assoupissement, que ne dissipèrent guère ni la lecture par Fourcroy d’un mémoire sur les détonations du muriate suroxygéné de potasse, ni les divers exposés scientifiques qui lui emboîtèrent le pas ; la récitation d’un long poème d’Andrieux par Monvel, membre de l’Institut et acteur de la Comédie française, arriva juste à point pour réveiller l’auditoire. Après cet intermède lyrique, d’autres discours « techniques » furent prononcés, parmi lesquels on relève un mémoire de Cuvier sur les différentes races d’éléphants. Une ode de Lebrun sur l’Enthousiasme sut réveiller de nouveau l’attention et la cérémonie se clôtura par des expériences de Fourcroy, au bruit assourdissant des explosions du muriate. On devine ainsi pourquoi, dès le Consulat, on en revint à la raison : le 23 janvier 1803 une nouvelle organisation fut proposée par le ministre de l’Intérieur Chaptal.
Selon la réforme, l’Institut national comprenait désormais quatre classes correspondant aux académies supprimées par la Révolution : une classe de Sciences physiques et mathématiques (l’équivalent de l’ancienne Académie royale des Sciences), une seconde de Langue et Littérature françaises (on évitait encore les mots d’Académie française), une troisième d’Histoire et Littérature anciennes (autrement dit l’ancienne Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres), enfin une dernière des Beaux-Arts (réunissant les académies royales de peinture et de sculpture, de musique et d’architecture). Les quatre classes renouaient de fait avec leur tradition d’autonomie et d’indépendance, mais elles continuaient à ne former qu’un seul corps : l’Institut. On continua à se réunir toujours en commun, mais seulement quatre fois l’an à l’occasion de séances extraordinaires. Quant à la classe des Sciences morales et politiques qui, par la voix de quelques-uns de ses membres, avaient eu le tort de s’opposer au Concordat, elle disparaissait en tant que corps unifié ; elle ne devait reparaître qu’en 1832, sous l’impulsion de Guizot, le père de l’Académie des Sciences morales et politiques. Notons que c’est en 1805 que l’Institut de France fut transféré dans les locaux prestigieux de l’ancien Collège des Quatre-Nations, autrefois fondé par Mazarin ; la célèbre coupole du quai de Conti est alors devenue le fleuron de l’emblématique du « monde vert ».