Prix et Fondations Prix du Budget 2025
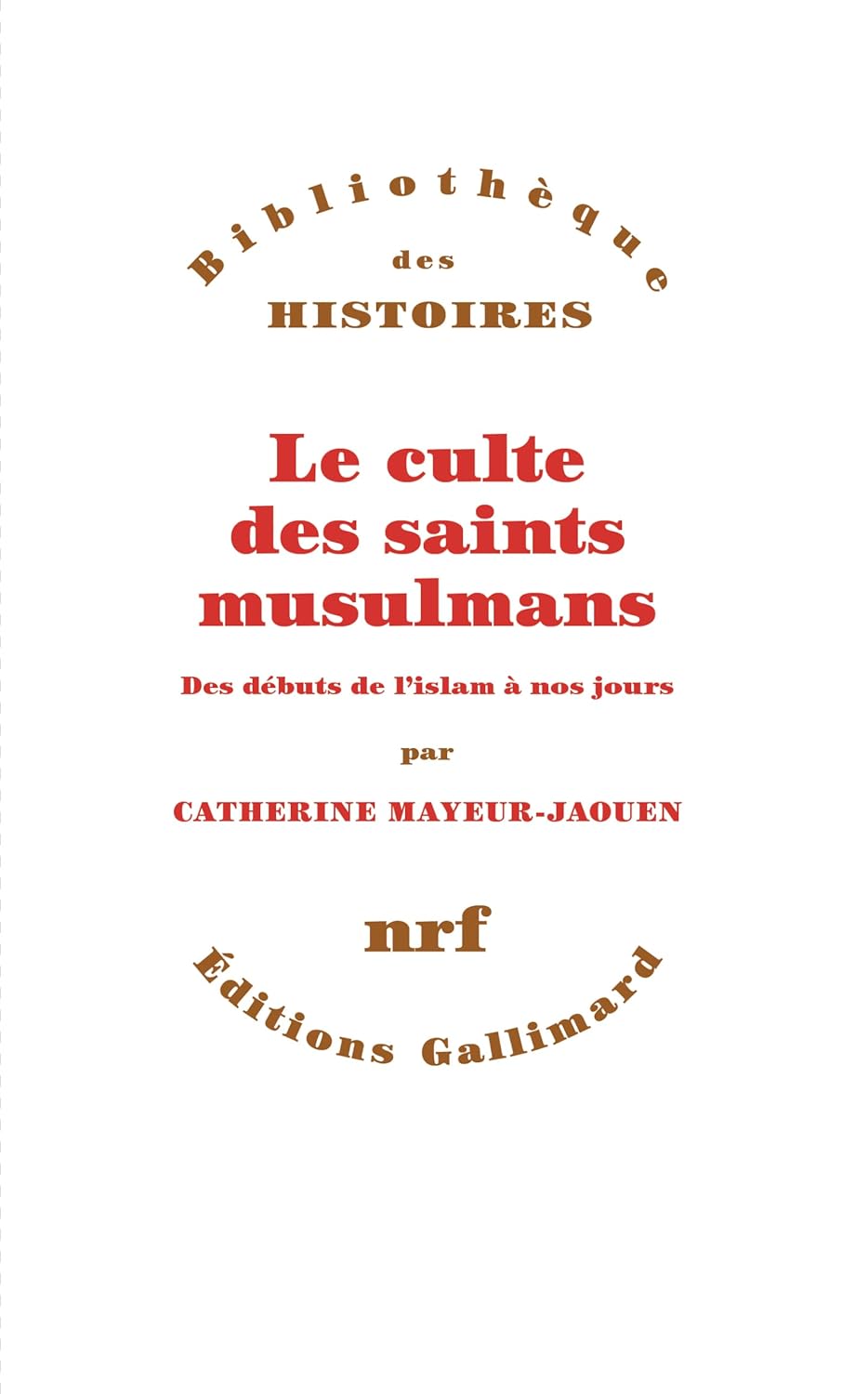
L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres recommande la lecture de l’ouvrage intitulé Le culte des saints musulmans des débuts de l’islam à nos jours de Catherine Mayeur-Jaouen, lauréate de son prix du Budget 2025.
Pour obtenir des informations supplémentaires concernant cet ouvrage, veuillez cliquer ici.
Hommage présenté par M. Jean-Michel MOUTON, membre de l’Académie, lors de la Séance de l’Académie du 14 mars 2025.
« J’ai l’honneur de déposer sur le bureau de l’Académie, de la part de son auteur, le livre de Catherine Mayeur-Jaouen, Le culte des saints musulmans des débuts de l’islam à nos jours, Paris, Éditions Gallimard, 2024, 622 p.
Ce volume reprend un projet ancien de l’auteure, celui d’écrire une histoire du culte des saints qui lui avait été demandée voilà plus de 20 ans pour la collection « Islamiques » dirigée par Dominique et Janine Sourdel aux PUF. Depuis le projet a pris de l’ampleur et couvre désormais l’ensemble du monde musulman des origines à nos jours. Dès l’introduction, très éclairante, l’auteure rejette les attaques – qu’elle va démonter une à une dans l’ouvrage – qui depuis le XIXe siècle n’ont cessé de discréditer ces pratiques, les qualifiant de paganisme mal islamisé, d’islam des classes populaires, voire analphabètes, d’islam des campagnes et des femmes. C. Mayeur-Jaouen prend d’emblée le contre-pied des réformistes musulmans qui affirment que le culte des saints « n’est pas l’islam véritable ».
L’ouvrage suit un plan chronologique depuis l’apparition en pleine lumière du culte des saints au IXe siècle (même si l’auteure pense qu’on peut le faire remonter quasiment à l’époque du prophète Muḥammad) jusqu’aux développements les plus contemporains avec la destruction massive des mausolées de saints par Daesh en Irak ou en Syrie ou encore par les autorités chinoises au Xinjiang. Deux chapitres (V et VI) échappent à ce classement et sont consacrés : d’une part aux lieux qui peuvent être très divers et aux rituels véritables marqueurs d’un islam ancré dans le temps et dans l’espace ; d’autre part aux pèlerins, notamment aux femmes auxquelles ces cultes sont pleinement ouverts, et aux fidèles des lieux saints partagés entre différentes communautés.
En étudiant l’origine du culte des saints, l’auteure s’élève contre l’idée, longtemps véhiculée par les orientalistes puis par les réformistes musulmans, selon laquelle ce culte serait une survivance païenne, les mêmes lieux étant tour à tour récupérés depuis l’Antiquité par les religions dominantes pour vénérer parfois les mêmes saints comme les prophètes antéislamiques. Si de tels cas existent comme par exemple le culte au mausolée d’Abû l-Hajjâj dans les ruines du temple de Louxor, les sanctuaires sont en majorité des créations proprement musulmanes et, quand ils s’inscrivent dans une continuité, ils ne reprennent en rien des traditions et des rituels païens ou chrétiens et ne sont pas non plus le résultat d’un quelconque syncrétisme, mais le fruit d’une islamisation pleine et entière, fruit d’un processus long et graduel d’accaparement et de transformation du lieu ou de réécriture de la vie du prophète. De même, dans les pratiques et les rituels, le modèle repris d’un bout à l’autre du monde musulman est celui du pèlerinage à la Mecque, le ḥajj, avec la circumambulation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, le contact physique avec le tombeau du saint et les prières rituelles et d’invocations (du‘āt) et les vœux (nadhr) : « Les sanctuaires édifiés en l’honneur des saints sont autant de petites Mecque ».
L’essor du culte des saints s’explique d’abord par le succès du culte des imams chiites et des membres de leur famille, hommes et femmes, à partir des IXe-Xe siècles, notamment sous le patronage des Bouyides en Irak et en Iran et des Fatimides en Ifrîqiya et en Égypte. Se multiplient alors les mausolées et se développent des rituels qui pour certains resteront la caractéristique de cette branche de l’islam, comme celui du battement de coulpe. En réaction à ces nouvelles pratiques qui suscitent un enthousiasme populaire, la réaction sunnite reprend le modèle de la construction de mausolées en les consacrant à des saints dont les tombes sont nouvellement « inventées » comme celle des Compagnons du prophète ou des héros des premières conquêtes musulmanes, puis des oulémas ou des ascètes plus contemporains. C’est le soufisme qui, à partir du XIIIe siècle, va structurer ce culte des saints dans le monde sunnite : les tombeaux sont désormais intimement associés à des confréries qui deviennent des éléments structurants à la fois de l’espace et des sociétés locales. La large diffusion du waqf, ces biens de mainmortes dont les revenus assurent le financement du mausolée et du personnel qui lui est attaché, permet, avec le don des pèlerins, la survie économique, voire la prospérité, de ces institutions. Les confréries soufies associées au culte des saints sont aussi un des instruments de l’islamisation profonde des campagnes à la fin du Moyen Âge (en Égypte par exemple) et la propagation de l’islam vers de nouvelles contrées, notamment dans l’Asie du sud-est.
Le culte des saints devient un phénomène majeur de l’islam à partir de la dynastie mamlouke lorsque les sultans et les émirs financent la construction de complexes monumentaux bien souvent centrés autour d’un tombeau de saint dans les grandes villes et couvrent les campagnes de mosquées et de qubba-s, ces édifices à coupoles érigés au-dessus du cénotaphe du saint. C’est aussi à cette époque que le culte des saints se diffuse de façon massive aux marges du monde musulman, au Maghreb, en Anatolie ou dans le monde indien, accompagnant partout l’islamisation des territoires et présentant à la fois des traits communs et des particularismes locaux. L’époque dite des « trois Empires » (ottoman, safavide et moghol) marque véritablement l’apogée du phénomène dans l’ensemble du monde musulman du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. Les pouvoirs locaux multiplient la rénovation et la construction des sanctuaires, les dote de reliques indirectes (les ossements des saints n’étant pas utilisés comme reliques en islam), notamment du Prophète Muḥammad (marques de son pas dans la pierre, poils de sa barbe, vêtements, etc.). Le culte des saints, fortement soutenu par le pouvoir, devient, s’il n’a jamais cessé de l’être, une source de légitimation des dynastes musulmans.
Cette période de fort développement voit cependant surgir les premières critiques contre ces pratiques, émanant d’abord d’hommes de religion isolés comme Ibn Taymiyya, puis de mouvements naissants comme celui des wahhabites en Arabie. Cela conduit insensiblement à un tournant majeur de l’islam à la fin du XVIIIe siècle : le culte des saints fait l’objet, durant les XIXe et XXe siècles, d’un procès en arriération. L’explosion urbaine et l’exode rural, le développement de l’instruction masculine puis féminine, les progrès de la médecine et la chute de la mortalité infantile, les contacts avec l’Occident ne serait-ce que par le biais de la colonisation sont autant de facteurs qui vont rendre tout d’abord moins nécessaire le culte des saints, par exemple des saints guérisseurs, faire régresser l’espace physique réservé à son implantation et encourager le développement des mouvements réformistes. Ceux-ci rejettent le culte des saints assimilé à l’associationnisme païen. L’intercession du saint (tawassul) auprès de Dieu qui est au cœur de cette spiritualité est rejetée et les mawlid-s, c’est-à-dire les fêtes des saints qui scandent le calendrier des quartiers et des villages, sont condamnés pour être des moments de mixité sexuelle et religieuse, de plaisir (musique, danses, poésies) et de débauche.
Une autre cause de ce recul a été, après la fin de la colonisation, la prise de contrôle des sanctuaires et de leurs finances par les États post-coloniaux qui se sont appuyés sur le culte des saints pour développer un islam national comme au Maroc ou en Égypte. Le mausolée perd alors une partie de sa sacralité au profit d’une patrimonalisation du lieu et d’une folklorisation des pratiques (ex. les derviches tourneurs). La lente sécularisation de ces lieux a transformé aujourd’hui certains d’entre eux en hauts lieux du tourisme.
Dans le dernier chapitre consacré au culte des saints depuis 1979, date de la révolution iranienne, l’auteure dresse un tableau contrasté. D’un côté, le monde chiite, est marqué par un renouveau spectaculaire du culte des saints tant en Iran que dans les pays où se trouvent une communauté chiite (Irak, Syrie, Liban). On assiste à une rénovation et bien souvent à une reconstruction des tombeaux de saints selon une architecture typiquement iranienne faite d’énormes coupoles et de façades couvertes de tuiles vernissées. Émergent également de nouvelles figures de la sainteté : des personnalités à la fois religieuses et politiques comme Musa Sadr ou l’ayatollah Khomeiny, mais aussi les martyrs des différentes guerres du Proche-Orient, voire des auteurs d’attentats suicides ! Du côté sunnite, un net recul est à noter, ne serait-ce qu’en se fondant sur la diminution des tombeaux de saints victimes de l’urbanisation, de la spéculation immobilière, puis des destructions de Daesh et des salafistes dans les années 2010. On notera, comme le fait très justement remarquer l’auteure, que les grands programmes de restauration, de l’Unesco notamment, après les destructions de Daesh, portent rarement sur les mausolées de saints. Ce recul favorisé aussi par le développement d’un islam dématérialisé et déterritorialisé avec le développement des chaînes satellitaires, d’internet, des réseaux sociaux ne marque cependant peut-être pas l’inexorable extinction du culte des saints : « le monde du ghayb (invisible, inconnu) jadis dompté par les saints semble de retour ».
Ce ne sont là que quelques éléments de ce livre particulièrement foisonnant et dense qui décrit par exemple avec une extrême minutie la nature profonde de ce culte, les attentes des pèlerins, leurs pratiques et leurs contacts physiques avec les lieux. C. Mayeur-Jaouen parvient à livrer ce gigantesque panorama d’un phénomène majeur de la religion musulmane en se fondant sur des bases solides reposant à la fois sur une maîtrise impressionnante de la bibliographie et sur une très riche expérience de terrain qui rend très attachant ce monde des pèlerinages populaires musulmans. »

