Prix et Fondations Prix Gobert 2025
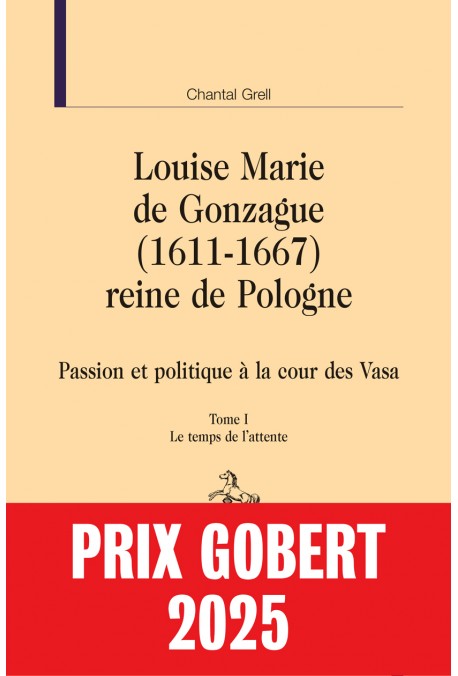
L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres recommande la lecture de l’ouvrage intitulé Louise Marie de Gonzague (1611-1667) reine de Pologne. Passion et politique à la cour des Vasa de Chantal Grell, lauréate de son prix Gobert 2025.
Pour obtenir des informations supplémentaires concernant cet ouvrage, veuillez cliquer ici.
Hommage présenté par M. Yves-Marie BERCÉ, membre de l’Académie, lors de la Séance de l’Académie du 10 janvier 2025.
Pendant plus de cinquante années au cours du XVIIe siècle Louise Marie de Gonzague a été spectatrice et personnage majeur des chroniques politiques de l’Europe. Fille du duc de Mantoue, élevée à Paris, elle a d’abord été témoin juvénile de la vie intellectuelle de la capitale et des intrigues de la cour de France. A sa haute naissance, le sort avait ajouté la beauté et le charme, l’intelligence et l’habileté ; il lui réservait une aventure politique fabuleuse. Il se trouva qu’en 1644, le destin l’envoya bien loin à l’Est recevoir la couronne de Pologne. Pour le restant de son extraordinaire carrière, il lui appartint de gouverner cette nation slave entourée d’ennemis et accablée de guerres incessantes. La reconstitution des étapes de sa vie dépasse donc le genre et la mode de la biographie historique, elle contribue à une histoire des institutions et des évènements aux dimensions d’un siècle et d’un continent.
Mme Chantal Grell, professeur à l’Université de Paris-Saclay, éminente spécialiste de l’histoire culturelle et politique des Temps modernes, a retrouvé dans la biographie de cette héroïne improbable, des directions de recherche qui lui sont familières : variabilité de l’écriture de l’histoire, comportements des sociétés princières, naissance des sciences exactes et particulièrement de l’observation des astres qui s’imposait à tous les savants européens de ces époques.
L’ampleur de la documentation est considérable, à la mesure d’un sujet multiple qui illustre d’abord le paysage intellectuel des hôtels parisiens à l’époque de Louis XIII et doit ensuite rendre compte de plus de trente décennies des chroniques politiques et guerrières de l’Europe orientale. Aux Archives nationales ont été consultés les papiers du roi Jean Casimir, retiré et mort en France, et puis les fonds de l’étude de M°Bontemps, traitant la fortune des ducs de Nevers. Les Archives des Affaires étrangères conservent les correspondances des ambassadeurs français en Pologne, Brégy, Lumbres et Bonzi de 1643 à 1668. Les fonds de manuscrits du Musée Condé au château de Chantilly ont fourni une dizaine de volumes de correspondance active et passive de la reine Louise Marie. Au département des Mss. de la BnF. ont été utilisés notamment les volumes de lettres de Pierre Des Noyers, secrétaire de la reine, à Ismaël Boulliau, astronome, 1655-1692. Parmi les sources imprimées, on remarque les éditions des lettres d’Angélique Arnauld, de Lumbres, de Michel de Marolles, etc. Quant aux études récentes sur la reine et son époque, il convient d’y noter les travaux de Francesca De Caprio, Robert Fost, Karolina Targosz et surtout de Maciej Serwanski. Il faut remarquer que l’érudition généreuse de Ch.Grell lui fait publier de longs extraits des correspondances, qui font ainsi cadeau aux divers spécialistes du XVIIe siècle d’un véritable outil de travail.
Sur ses vingt ans, Louise Marie fut pendant plusieurs années ouvertement courtisée par le duc d’Orléans ; elle pouvait alors sembler promise, si le sort le voulait, à devenir un jour reine de France. Ensuite, en dépit des malheurs de son père, tels que les ravages du duché de Mantoue et l’insuffisance des revenus de ses domaines à Charleville et Nevers, la princesse était admirée dans les rendez vous aristocratiques et les ruelles littéraires que tenaient de grandes dames parisiennes. Ce fut ainsi que son aimable prestige vint à séduire les grands seigneurs étrangers qui venaient à passer par Paris. Dans le système des alliances et conflits de l’Europe des princes, les mariages entre les familles souveraines étaient de brillants enjeux. Les mains des filles de naissance princière, leur grâce et de leur dot, étaient donc des problèmes diplomatiques ; les ambassadeurs et les riches négociants étrangers avaient pour tâche de découvrir les détails et les secrets des cours et de se procurer les portraits des demoiselles à marier.
Ladislas IV, roi de Pologne, prématurément veuf d’une infante autrichienne, rêvait d’épouser une princesse de France, une dame venue de Paris. Il en espérait pour son royaume un appui contre les menaces de voisins belliqueux suédois, prussien, moscovite, impérial et ottoman. En France, Mazarin favorisait un tel mariage selon la pratique traditionnelle d’une alliance de revers en Europe centrale contre la puissance de l’empire des Habsbourg. Le couronnement d’une française à Cracovie ferait converger les intérêts de deux royaumes unis par le catholicisme, en dépit des difficultés d’éloignement dans l’espace et de différences de modes de gouvernement. Les évolutions des institutions en France tendaient alors , malgré les révoltes et les guerres civiles, vers un centralisme autoritaire, régime auquel bien plus tard les historiens donneront le nom d’ « absolutisme ». Au contraire, dans l’Union polono-lituanienne, le roi, élu par des assemblées de noblesse, ne pouvait lever ni d’impôts ni de soldats sans le consentement des diètes de l’ensemble des noblesses polonaise, balte, biélorusse et ukrainienne. Ces contradictions institutionnelles dominèrent les querelles politiques des décennies suivantes.
Le voyage du cortège de Louise Marie, de France jusqu’en Pologne, dura quatre vingt dix sept jours. A son arrivée, en mars 1646, elle découvrit que Ladislas était lascif, impotent, impuissant et voué à une mort prochaine ( il mourut le 20 mai 1648). Les urgences militaires maintinrent la reine au pouvoir. Elles hâtèrent l’élection d’un nouveau roi Jean Casimir, frère du défunt, et puis tout aussitôt son mariage avec Louise Marie ainsi confirmée dans son gouvernement. Le royaume se trouvait alors confronté au Sud dans les immenses plaines de l’Ukraine à une vaste et meurtrière révolte des Cosaques conduits par l’ataman Chmielniski. Aux sécessions cosaques s’ajoutaient encore sur toutes les frontières des avancées d’armées suédoise, prussienne et russe. Ces cinq ou six années de guerres désastreuses ont pris dans la destinée polonaise le nom de Temps du Déluge. La pauvre reine, victime de deux grossesses malheureuses, épouse d’un souverain sans grand caractère, essayait de gouverner selon des logiques françaises qui étaient souvent dénoncées comme étrangères et abusives. Son règne se trouva identifié aux années de malheur, où elle devait faire face aux intrigues nobiliaires et aux déroutes de ses troupes. Dès l’année 1655, le couple royal avait été contraint de chercher refuge en Silésie, territoire impérial. L’année suivante, le ralliement en grand nombre de cavaliers tatares permettait de reprendre des villes et des espaces ; la reine assumait parfois le commandement, s’exposant au péril de sa vie. Elle faisait établir les horoscopes de ses adversaires et de leurs généraux, avant de conduire elle même les négociations avec les émissaires du roi de Suède ou de l’Electeur de Brandebourg, duc de Prusse. Elle avait reçu à l’été 1659 l’appui et les conseils d’un ambassadeur français, Antoine de Lumbres, homme de confiance de Mazarin. Contre la Suède elle bénéficiait aussi des appuis maritimes des Danois et des Hollandais. Enfin, grâce aux interventions françaises, la paix entre les belligérants des guerres du Nord fut signée le 3 mai 1660 à l’abbaye d’Oliva, près de Gdansk.
Alors que Jean Casimir dépourvu de descendance mais bien vivant était encore engagé dans les combats, Louise Marie avait envisagé d’assurer la succession et la stabilité de la couronne en convoquant une diète chargée de désigner le futur souverain par anticipation, vivente rege. Dans ce but, il fallait choisir et susciter des candidatures de dignitaires attachés à une grande puissances, exclure un russe ou un suédois, avancer plutôt un archiduc autrichien ou un prince français. Les ambassadeurs, Lumbres pour Paris et Lisola pour Vienne, proposaient des noms, promettaient des alliances et des subsides. Il leur fallait trouver des partisans dans les plus fameuses familles de la noblesse, notamment deux grands seigneurs qui furent tour à tour hetmans de camp de la couronne : Stepan Czarniecki, soutien de la reine et valeureux adversaire des Suédois, et le puissant et savant Georges Lubomirski, voievode de Cracovie, appui du parti impérial. Louise Marie avait imaginé de faire accéder au trône de Pologne un illustre nom de France, le jeune duc d’Enghien, fils du Grand Condé. Mazarin, bien sûr, ne voulut pas tout d’abord favoriser le fils de son pire ennemi, il se résigna à soutenir sa candidature en septembre 1659, lorsque le prince de Condé, établi encore à Bruxelles, eut enfin obtenu la grâce de son retour à la cour de France. Après la mort de Mazarin, Louis XIV accepta de soutenir d’arguments et de promesses la candidature du jeune Enghien, époux en 1663 d’Anne de Bavière. Le cardinal de Bonzi, évêque de Béziers, fut expressément chargé de plaider la cause devant la Diète en 1665. En vain.
La reine Louise Marie, accusée de tyrannie, défiée plusieurs fois par des prises d’armes de noblesse, vint à mourir le 10 mai 1667. Le roi Jean Casimir souhaita alors abdiquer et léguer le trône à Enghien ; il se retira en France et mourut à Nevers dans les terres des Gonzague en décembre 1672. Cependant la Diète réunie en 1669 n’avait pas suivi ses intentions et avait repoussé les démarches des émissaires français ; Enghien avait été vite exclu. Le nouveau roi Michel Wisnowiecki, époux d’Eléonore d’Autriche, était le candidat des Impériaux ; il régna de 1669 à 1673.
Les terribles ravages des guerres pendant le gouvernement de Louise Marie, l’échec de ses tentatives de réforme du statut royal et de centralisation du pouvoir assombrirent dans la postérité son image politique. Elle avait effectivement échoué à doter la monarchie polonaise de la stabilité d’un pouvoir héréditaire. Alors que la France avait eu pendant des siècles la chance de transmettre le trône à des fils ainés, les souverains polonais n’avaient pas eu depuis 1573 de postérité masculine et n’avaient pu instaurer dans les faits ou dans la coutume une continuité dynastique. L’hypothèse n’était pas encore rejetée ; le principe électif n’aurait pas empêché que les Diètes ne consentissent volontiers à transmettre la couronne à un héritier masculin. La mort en 1647 du petit Sigismond Casimir fils de Ladislas, et les grossesses malheureuses de Louise Marie en avaient dans l’immédiat écarté la possibilité. Les circonstances avaient permis cet investissement dynastique dans l’Empire où les Habsbourgs se succédaient depuis 1440, de même en Suède avec la trajectoire des Vasa, de même au Danemark où les Etats généraux du royaume choisirent en 1660 le procédé de succession héréditaire. En Pologne, la prérogative des diètes de la noblesse de désigner le souverain se transformait avec le temps en un principe original et essentiel de cette nation, le signe de sa liberté fondamentale.
L’histoire ne peut jamais être re-écrite. On peut, du moins, admettre que les avatars du XVIIe siècle ont scellé le destin des successions malencontreuses qui surviendraient au cours du siècle suivant et qu’ils annonçaient les sinistres partages du territoire qui arriveraient plus tard. Plus, sans doute, que les malheurs des guerres, les projets inefficaces et impopulaires de la reine Louise Marie s’efforçant de changer les institutions ont discrédité sa mémoire. L’historiographie polonaise traditionnelle a préféré célébrer la légendaire liberté de la nation et de ce fait a persisté longtemps à à critiquer cette reine importune. C’est un pan d’histoire, continental et séculaire, que la monumentale étude de Chantal Grell vient à renouveler.

