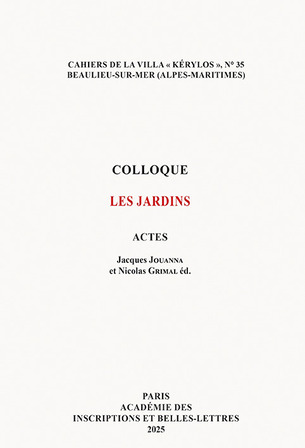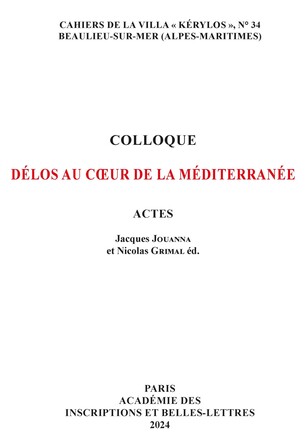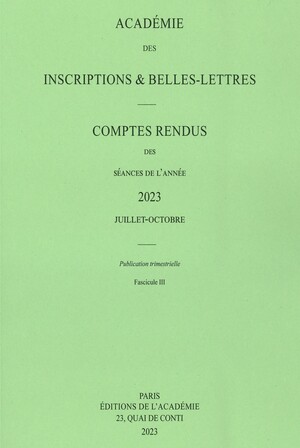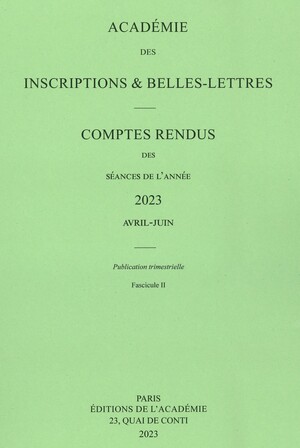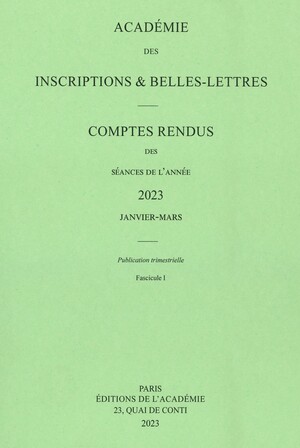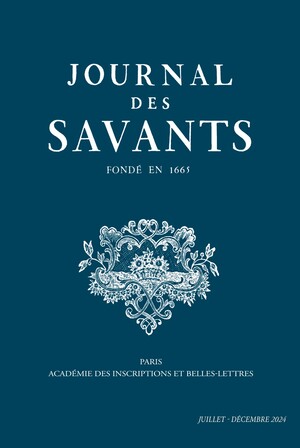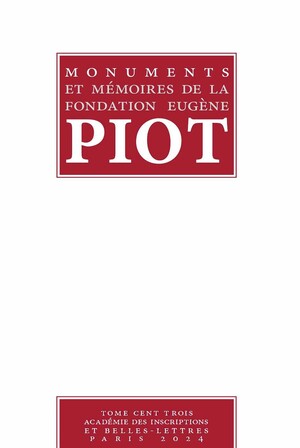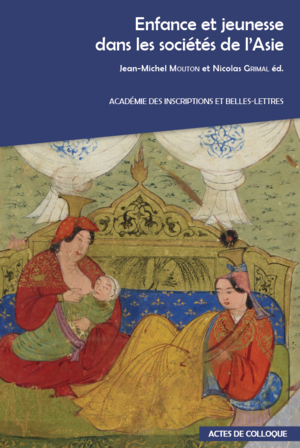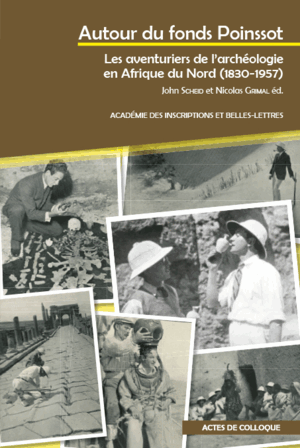Publications Cahiers de la Villa « Kérylos » N°26
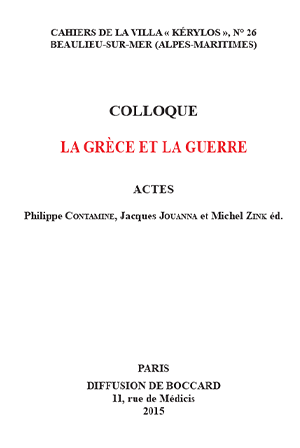
La Grèce et la guerre
Actes du XXVe colloque de la Villa Kérylos, 3-4 octobre 2014
M. ZINK, J. JOUANNA et Ph. CONTAMINE éd.
Année de parution : 2015
315 pages, 33 illustrations.
Présentation
Depuis Homère, la guerre, à de fréquents intervalles, est venue voiler de son ombre le soleil radieux censé éclairer l’espace hellénique, qu’il soit terrestre ou maritime. En cette année de commémoration du déclenchement de la Première guerre mondiale, à laquelle la Grèce prit part, sous des formes diverses (il n’est que de songer à l’action de Venizélos et à l’ouverture du « front d’Orient »), ce thème s’est comme imposé à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour son XXVe colloque de la Villa Kérylos. Sans discontinuer, poètes, philosophes, historiens et artistes de la Grèce antique ont porté une attention considérable au phénomène de la guerre. La permanence de ce thème d’inspiration et de réflexion, par-delà les siècles et les types variés qu’il revêtit, apparaît remarquable car il reflète la continuité, non exempte d’inflexions, d’un ensemble de pratiques et de valeurs masculines (comme le genre du vocable Polemos le souligne) ayant largement contribué à modeler les diverses formes de sociétés qui s’échelonnèrent au cours de l’histoire grecque, depuis les temps archaïques jusqu’aux monarchies hellénistiques, en passant par l’époque classique des cités et des soldats citoyens. C’est que la guerre, « Père de toutes choses » selon Héraclite, embrassait tous les aspects de la vie politique, sociale, juridique, économique et religieuse. C’est qu’elle constituait aussi, du fait de son caractère récurrent, l’état le plus commun des relations entre entités étatiques au sein de la Grèce et avec ses voisins, à tel point que l’histoire des Hellènes demeure, aujourd’hui encore, scandée dans les chronologies par les grands conflits qui l’animèrent. Atteste également de la présence endémique, et selon divers modes, de la guerre dans la vie des Grecs une masse énorme de témoignages matériels ayant franchi les siècles, à commencer par une foisonnante documentation épigraphique, un répertoire iconographique extrêmement abondant ou bien encore d’impressionnants vestiges architecturaux parmi lesquels se distinguent enceintes et fortifications. Par le biais d’angles d’approches variés, la première partie de ce colloque cherchera à mettre en valeur comment les Grecs vivaient et concevaient la guerre, quelle influence elle exerçait sur leurs modes d’organisation, leur mœurs ou leur culture, bref quelle marque elle imprima, en fonction de ses mutations propres, sur les divers niveaux de manifestation de leur civilisation et sur son destin. La seconde partie du colloque ne se contentera pas d’une promenade martiale, aux dimensions techniques et sociales, institutionnelles et culturelles, à travers la longue période médiévale, au temps de l’empire byzantin, assez tôt sur la défensive : elle se proposera également d’évoquer l’influence du modèle de la Grèce antique sur l’art militaire au siècle des Lumières, sur la peinture d’histoire ainsi que le retentissement à travers l’Europe romantique de la guerre d’Indépendance.
La guerre et les historiens de la Grèce classique.
Après les livres de Pierre Ducrey, les études d’Yvon Garlan, les travaux de Kendrick Pritchett, de J. K Anderson ou de V. D. Hanson – et l’on se borne ici aux contributions récentes les plus marquantes – il peut sembler téméraire d’accepter de parler de la guerre dans la Grèce classique quand on n’a pas le privilège d’être, comme l’archéologue, l’épigraphiste ou le numismate, armé de documents nouveaux ; et j’ai parfois eu, en préparant cette communication, le sentiment inconfortable d’enfoncer des portes ouvertes…nL’une des premières questions qui peut venir à l’esprit est la suivante : pourquoi les historiens de la Grèce classique sont-ils principalement, sinon exclusivement, des historiens des conflits armés – guerres médiques chez Hérodote, guerre du Péloponnèse chez Thucydide ou chez son continuateur Xénophon, qui retraça dans les Helléniques l’histoire des conflits où s’opposèrent les cités grecques jusqu’à l’intervention de Philippe ? Sans doute parce que la guerre est omniprésente dans le monde grec classique où l’on vit « traitant puis guerroyant » (Thucydide, I, 18). D’un bout à l’autre de l’histoire des Grecs, le fracas des armes se fait entendre ; la paix n’est qu’une trêve entre deux conflits. Les textes des traités l’indiquent, qui ne mentionnent généralement pas d’état de paix – εἰρήνη –, mais parlent de σπονδαί – un état de trêve consacré par des libations et un échange de serments – ou de ξύμβασις, l’accord, l’entente. Les durées de trêve prévues par ces σπονδαί sont généralement de dix à trente ans, par extraordinaire de cinquante ans, mais on précise alors que les serments doivent être renouvelés chaque année. Yvon Garlan a calculé qu’entre 490 et 338 – des guerres médiques à Chéronée – Athènes a guerroyé plus de deux ans sur trois en moyenne et n’a pas réussi à jouir de la paix dix ans de suite. En fait la paix, dont chacun s’accorde à chanter les louanges d’Homère à la fin de l’époque classique, n’est que « l’interruption contractuelle de la guerre », selon le mot souvent cité de Bruno Keil. (…) Monique TRÉDÉ
Les orateurs antiques entre guerre et paix
Les Anciens concevaient le discours rhétorique comme un moyen de préparer la guerre, de l’éclairer, de la justifier et de la mettre en perspective. Mais ils concevaient aussi le discours comme un moyen de suspendre la guerre, de la dépasser ou de l’éviter, quand le jeu institutionnel de la parole publique venait à se substituer au déploiement de la force. Pour les rhétoriciens, toujours prêts à peser le pour et le contre, la guerre et la paix formaient un couple dialectique. Il convient donc d’examiner successivement les discours au service de la guerre et les discours au service de la paix. La rhétorique et la guerre Démosthène ayant consacré sa carrière publique à prôner la guerre contre le royaume de Macédoine, ses observations sont significatives. Dès le début des hostilités, il recensa les facteurs qui faisaient la force de Philippe, par opposition à la situation d’Athènes : « Souverain absolu, [Philippe] décide seul de ce qu’il faut dire et de ce qu’il faut taire (kurion kai rhêtôn kai aporrhêtôn), il est à la fois le général, le maître, le trésorier. » Dans une monarchie, le roi était maître de tout, y compris de la parole, ce qui contrastait avec le fonctionnement de la démocratie athénienne, dans laquelle la guerre, comme tout le reste, était soumise à l’échange de discours publics et contradictoires, du type de la harangue même que Démosthène était en train de prononcer. Près de vingt ans plus tard, quand tout était perdu et que la Grèce était soumise à Alexandre, Démosthène revint sur ce thème, pour justifier rétrospectivement son action : « La situation de Philippe, contre qui nous luttions, examinez-la : tout d’abord, il commandait tout seul, en maître absolu, à ceux qui le suivaient (ce qui est le plus important pour la conduite de la guerre) ; ensuite ces gens avaient toujours les armes à la main ; puis il avait de l’argent en abondance et il faisait ce qu’il voulait, sans l’annoncer dans les décrets, sans délibérer publiquement, sans être traîné en justice par les sycophantes, sans encourir d’accusation d’illégalité, sans rendre de comptes à personne, absolument seul maître, chef, souverain de tout. Et moi, qui avais pris position contre lui (voici ce qu’il est juste d’examiner), de quoi étais-je maître ? De rien. En effet, tout d’abord, la faculté même de parler au peuple, seul droit qui fût mon partage, vous l’accordiez aussi bien aux salariés de Philippe qu’à moi et, chaque fois qu’ils l’emportaient sur moi (chose fréquente, quel qu’en fût le motif en chaque cas), vous vous sépariez après avoir délibéré dans l’intérêt de vos ennemis. » (…) Laurent PERNOT
Guerre et philosophie en Grèce ancienne : aux origines de l’art de la guerre.
I. Aux origines de l’art ou science de la guerre (polemikè) en Grèce ancienne chez les sophistes et chez le philosophe Démocrite au Ve siècle av. J.-C.La notion centrale est polemikè dont on vient de voir que c’est un art ou une science. « Sur quoi porte cette science ? », demanderait Socrate. Sur le polémos, répondrait-on. Mais que faut-il entendre exactement par là ? Le mot se définit par deux termes opposés : bien entendu polémos désigne la guerre par opposition à eirènè, la paix ; mais ce qui est plus important pour le définir c’est qu’il s’oppose aussi à la stasis, la dissension ou discorde, qui est une lutte entre factions à l’intérieur d’une cité, alors que le polémos désigne toute guerre faite par une cité contre un ennemi extérieur. Platon dans la République exprime clairement la distinction entre les deux notions : « L’inimitié avec des gens de la communauté s’appelle la dissension, tandis que l’inimitié avec des gens extérieurs à la communauté s’appelle conflit.» Bien entendu la communauté peut s’entendre de deux façons. Dans ce passage de la République, le philosophe l’entend, de façon idéale, en tant que communauté des Grecs contre les Barbares, dans une perspective panhellénique, comme ce fut le cas lors des Guerres médiques au début du Ve siècle. Mais c’est un idéal qui ne correspond plus à la réalité dans la seconde moitié de ce siècle où la guerre entre cités grecques était devenue la réalité première avec la rivalité entre Athènes et Sparte. On définira donc la polemikè comme l’art de la guerre ou la science du conflit mené par la cité contre un ennemi de l’extérieur, qu’il soit grec ou non grec. (…) Jacques JOUANNA
Du nouveau sur le combat des hoplites. Vraiment ?
Prologue : un changement de paradigmeDepuis que les hommes se font la guerre, ils s’efforcent de protéger leurs soldats. Seule exception, la mort de combattants par suicide. Ce phénomène est récent, du moins dans son amplitude planétaire, dans sa durée et dans sa violence. Qui dit mort par suicide d’un combattant songe immanquablement aux avions du 11 septembre 2001, aux attentats réalisés avec des véhicules bourrés d’explosifs ou encore à des jeunes gens portant des habits truffés de bombes. Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, en désespoir de cause, l’état-major japonais donna l’ordre à des pilotes-kamikazes de précipiter leurs avions sur les navires de la flotte américaine. La Suisse célèbre le suicide d’un combattant, devenu un héros national au même titre que Guillaume Tell, Arnold von Winkelried. Ce dernier, selon la légende, se serait jeté sur le mur formé par les longues piques du « carré » autrichien à la bataille de Sempach (1386). Il aurait créé ainsi une brèche dans la formation autrichienne et permis aux combattants suisses, armés de courtes hallebardes, d’atteindre les lanciers autrichiens, de déséquilibrer leur formation et de remporter la victoire. Au moment de se précipiter sur les lances autrichiennes, Arnold von Winkelried se serait écrié : « Prenez soin de ma femme et de mes enfants ! » Les pilotes japonais mouraient pour leur empereur. Quant aux combattants-« kamikazes » islamiques, ils sont mus par la foi, la volonté de combattre un monde qu’ils jugent injuste et l’assurance de trouver une vie heureuse dans l’au-delà en qualité de martyrs. La mort de combattants par suicide reste un phénomène exceptionnel, contraire aux traditions de la guerre et même, pourrait-on dire, au principe vital. (…) Pierre DUCREY
L’éphébie athénienne comme préparation à la guerre du IVe au IIe siècle av. J.-C.
Même si le mot éphèbos – formé sur hébè, « la fleur de la jeunesse », « la vitalité de la jeune pousse » – est certainement ancien, remontant au moins à la fin de la période archaïque (puisqu’il se trouve déjà indirectement attesté chez Hérodote, VI, 83, 1), l’éducation civique et militaire des jeunes gens dans les cités grecques n’est connue sous le nom de éphèbeia qu’à partir de l’époque d’Alexandre le Grand. Aussi l’éphébie a-t-elle relativement peu retenu l’attention des historiens de la Grèce classique (la limite étant fixée, un peu arbitrairement, aux années 338-323 av. J.-C.). Pourtant, dès le premier de ses deux grands volumes consacrés à la Civilisation grecque, celle de l’époque archaïque et classique justement, notre si regretté confrère François Chamoux faisait une place à l’éphébie. Il montrait que l’éducation militaire n’était pas un monopole de l’aristocratique et belliqueuse cité de Sparte, mais qu’elle était à l’honneur aussi dans la démocratique et (relativement) plus pacifique Athènes. Celle-ci, écrivait-il, « a conçu à cette fin l’institution de l’éphébie, très caractéristique de l’aspect militaire que revêt dans la cité antique la condition du citoyen. Nous ne connaissons le détail du système, ajoutait-il, que pour la période postérieure à la bataille de Chéronée, grâce à la Constitution d’Athènes d’Aristote, ouvrage rédigé […] à une époque où l’éphébie venait d’être réorganisée. Mais il est vraisemblable que, dans son principe au moins, l’institution était plus ancienne ». Et d’évoquer alors la manière dont se déroulait, deux années durant, ce service militaire en même temps que cette formation civique. Près de vingt ans plus tard, dans sa monumentale Civilisation hellénistique, le même savant montrait que, sous les successeurs d’Alexandre encore et en dépit de la place prise alors par le mercenariat, « le lien ne fut jamais brisé entre le gymnase et l’armée », et il illustrait la chose par le développement que, partout dans le monde grec (jusque dans la lointaine Bactriane), prit alors le gymnase, lieu d’exercice physique et intellectuel pour les jeunes gens de condition libre ; et cela en particulier dans les cités où une éphébie de type attique – c’est-à-dire militaire dans son principe – s’était implantée plus ou moins rapidement ; il démontrait que l’entraînement aux armes y était resté la règle, les jeunes gens pouvant être appelés à défendre le territoire de la cité contre des attaques de brigands ou de pirates. Mais notre maître ne prétendait évidemment pas faire le catalogue des attestations, essentiellement épigraphiques, de l’éphébie telle qu’elle existait hors d’Athènes. (…) Denis KNOEPFLER
L’organisation de la guerre macédonienne : Philippe II et Alexandre.
Les exploits militaires de Philippe II de Macédoine et surtout d’Alexandre le Grand enflamment l’imagination de militaires, de savants, d’écrivains de tout genre depuis des générations et suscitent une bibliographie foisonnante, où les ouvrages les plus sérieux côtoient les textes les plus fantaisistes, qu’il serait oiseux d’égrainer. Pour s’en tenir à l’essentiel, la contribution la plus approfondie de l’organisation de la guerre macédonienne sous Philippe et Alexandre avant le départ de ce dernier de Macédoine est le chapitre de 45 pages « Philip and the Army », que le savant Britannique Guy Griffith a écrit pour le second volume de l’ouvrage monumental A History of Macedonia paru en 1979. Son auteur réunissait en sa personne les qualités de l’helléniste, du spécialiste de la chose militaire, de l’historien sensible aux réalités sociales qui conditionnent les formes institutionnelles et du grand amateur de chevaux. Quiconque voudra aujourd’hui traiter de l’organisation militaire sous les derniers Téménides sera obligé de suivre ses pas. Il ne pourrait y ajouter comme contribution propre que la seule perspective qui manque au chapitre de Griffith, non pas parce que ce dernier l’avait négligée, mais parce qu’au moment où il écrivait les sources nécessaires pour lui donner la place qu’elle méritait n’étaient pas encore disponibles. Il s’agit des réformes administratives de Philippe II et d’Alexandre dont les réformes militaires sont le préalable ou le corollaire. (…) Miltiade HATZOPOULOS
Payer la guerre en Grèce antique.
La guerre est constamment présente à l’horizon de la cité grecque et la question de savoir comment y faire face vient au premier rang de ses réflexions politiques. Ainsi, la guerre est derrière le schéma élaboré par un théoricien du début du Ve siècle, Hippodamos de Milet, qui préconisait que la cité soit divisée en trois catégories de citoyens : les artisans, les paysans et les guerriers possesseurs des armes. Pour répartir équitablement les droits et les charges, il fallait de même diviser la terre en trois parts, celle qui assurerait les besoins des cultes, celle des paysans et celle d’où les guerriers tireraient leur subsistance. Le système est caractéristique des schémas associant les revenus de la terre et l’organisation militaire de la cité. Mais c’était théoriser pour un temps prémonétaire qui était déjà largement passé à l’époque où Hippodamos rédigeait son traité. Au temps de Thémistocle et de la toute-puissance de la flotte athénienne, vouloir confier la défense de la cité aux bénéficiaires d’une rente foncière procurée par le travail d’esclaves communautaires était déjà un système suranné, même s’il en existait toujours des applications variées dans le Péloponnèse, à Sparte, mais aussi en Crète ou en Thessalie. Ailleurs, il n’avait pas été mis en application ou avait été abandonné, notamment sous l’action de tyrans s’appuyant sur des troupes qu’ils entretenaient et qui leur étaient liées par une fidélité personnelle. Créée en Asie Mineure au début du VIe siècle, la monnaie procura d’emblée de nouveaux moyens pour payer la guerre. Dès l’origine, dans « l’Empire lydien », elle est associée à la puissance militaire, fournissant aux souverains de Sardes le principal instrument de leur domination, le tribut payé en pièces de monnaie par les cités et les peuples soumis, comme Milet, et l’exemple donné par les Lydiens sera immédiatement repris par Cyrus, le conquérant perse. Quand la monnaie s’installe en Grèce à partir du milieu du siècle, elle joue un rôle indéniable dans l’installation et le maintien de certaines tyrannies. (…) Olivier PICARD
Le feu grégeois, ses vecteurs et ses engins de propulsion.
Ancêtre présumé de la poudre à canon, de la fusée, du napalm, du bazooka, du lance-flammes et du cocktail Molotov, le feu grégeois (ignis graecus), arme secrète des Byzantins, a fait l’objet d’une littérature surabondante, oeuvre de chimistes, d’ingénieurs du pétrole ou d’officiers à la retraite. Elle contraste avec la surprenante discrétion des textes anciens. Selon Théophane (entre 810 et 815) et Zonaras (mort après 1166), ce fut lors du siège de Constantinople, vers la cinquième année de Constantin III (673) que Callinicos, architecte réfugié d’Héliopolis en Syrie, prépara le feu maritime, mit le feu aux vaisseaux des Arabes et les brûla complètement avec leur équipage. Sur le produit lui-même, les historiens se bornent à des adjectifs : feu maritime, feu artificiel (d’artifice), feu romain, feu énergique. Plus intéressantes sont les mentions de consistance – feu liquide ou feu mou –, ou de provenance, feu médique. Constantin Porphyrogénète, rappelant à son fils qu’il s’agit d’un secret d’État, évoque le moyen de propulsion : « Tu dois pardessus toutes choses porter tes soins et ton attention sur le feu liquide qui s’expulse par les tubes ». Pour résoudre le double problème de la composition et de la propulsion, deux textes peu connus apportent des éléments nouveaux. (…) Robert HALLEUX
Alexandre le Grand, modèle et précurseur des croisés ?
Le plus illustre des héros grecs qui peuplent l’imaginaire du Moyen Âge occidental est l’incarnation même de la guerre. Le récit qui renouvelle aux environs de l’an mil dans le monde latin le souvenir de la destinée étonnante et des aventures fabuleuses d’Alexandre le Grand (c’est bien sûr de lui qu’il s’agit) est en effet connu sous l’appellation d’Historia de preliis, « Histoire des batailles » – titre sans doute apocryphe et tardif, mais en parfaite consonance avec l’incipit de l’oeuvre, dont les tout premiers mots évoquent « les combats et les victoires des guerriers d’exception », certamina et victorias excellentium virorum. L’Historia de preliis dérive de la traduction, réalisée dans les années 950 par l’archiprêtre Léon de Naples, de l’une des nombreuses versions du roman grec faussement attribué à Callisthène. Elle est appelée à connaître, jusqu’au début de l’âge de l’imprimerie, un succès formidable : aux trois recensions latines, assez différentes entre elles, élaborées entre le milieu du XIe siècle et la fin du XIIe en Italie du Sud, dont nous conservons aujourd’hui respectivement 18, 42 et 45 manuscrits, viennent s’ajouter des dizaines de traductions, adaptations, transpositions effectuées dans toutes les langues vernaculaires de l’Europe. Ce succès n’était pourtant pas garanti au départ. Car l’image d’Alexandre que les premiers siècles médiévaux héritent de l’Antiquité est plutôt sombre et négative. Elle est largement modelée par la condamnation sans appel du Conquérant et de son oeuvre par l’historien chrétien Paul Orose, disciple de saint Augustin, dont Bernard Guenée a montré qu’il était l’historien le plus populaire au Moyen Âge. Par exemple : « En ces jours naquit Alexandre le Grand, vrai gouffre de malheurs et tempête absolument sinistre pour l’Orient tout entier » ; (…) Jean-Yves TILLIETTE
La défense de l’empire romain d’orient lors de la quatrième croisade.
Villehardouin a souligné le caractère quasi miraculeux de la prise de Constantinople aux yeux des croisés : « Ils (les croisés) devaient bien en louer notre Seigneur : car ils n’avaient pas plus de vingt mille hommes armés, entre eux tous, et avec l’aide de Dieu ils avaient pris quatre cent mille hommes, et dans la plus forte ville qui fût en tout le monde. » Cette réflexion, nullement feinte, exprimait bien l’impression chez les Latins d’avoir accompli un exploit sans comparaison en leur temps. Aucun officier du camp d’en face n’a donné son sentiment sur ce qui paraissait aux yeux des Orientaux comme une étrange défaite. Les historiens postérieurs et notamment ceux de notre époque tiennent pour acquis les résultats de cette extraordinaire expédition militaire. Pourtant, rien ne laissait présager la prise d’assaut de Constantinople lorsque le projet de la croisade commença de s’élaborer, car c’est au prix de plusieurs changements de plan que l’armée latine débarqua face à la capitale de l’Empire byzantin. Ce caractère imprévisible des événements a singulièrement pesé sur la préparation militaire des Grecs et sur l’issue de la croisade. Le récit des faits est bien connu, au moins dans ses grandes lignes, car nous disposons, comme pour la première croisade, d’un grand nombre de sources, certes venant davantage du côté des assaillants que de celui des défenseurs. En revanche, les ressorts qui conduisirent aux profonds changements de la route initialement prévue restent l’objet de spéculations pour les historiens qui se partagent entre ceux qui croient à la manipulation des chefs latins par les Vénitiens et ceux qui privilégient la spontanéité relative de leurs décisions face à des situations imprévues. (…) JEAN-CLAUDE CHEYNET
Quand la Morée était française : « Faits d’armes et de chevalerie ».
Un siècle de domination françaiseCorrespondant au Péloponnèse antique et actuel (soit quelque 22 000 km2, 5 000 de moins que la Bretagne), la principauté de Morée (il est aussi parlé dans les sources de principauté d’Achaïe) était avant 1204 un morceau politiquement et économiquement périphérique de l’empire byzantin, quoique ses ports servissent d’escales sur la route de Constantinople. Neveu du célèbre chroniqueur, le champenois Geoffroi I de Villehardouin, lors de la quatrième croisade, se dirigea sans détour vers la Terre sainte pour y accomplir son pèlerinage. Ayant appris la prise de Constantinople, il rebroussa chemin et débarqua à Modon, au sud-ouest de la Morée. Pendant l’hiver 1204-1205, il entama la conquête de la péninsule, de concert avec un seigneur grec. Celui-ci étant mort, une révolte de la population locale s’ensuivit. Geoffroi s’allia alors à Boniface de Montferrat, roi de Thessalonique, en route vers la Morée. Boniface abandonna bientôt ses droits au bourguignon Guillaume de Champlitte, si bien que la conquête fut l’oeuvre commune de Guillaume et de Geoffroi. Ceux-ci organisèrent leur nouveau territoire selon les principes de la féodalité d’Occident. De leur côté, les Vénitiens obtinrent les ports de Modon (Methoni) et de Coron. La mort en 1209 de Guillaume et de son frère mit un terme à ce qui aurait pu devenir la dynastie des Champlitte. Mais déjà un « parlement », réuni au coeur de l’Élide, à Andreville (Andravida), dans l’ouest de la Morée, dont Clarence (Klarentza) était le débouché sur la mer, établissait le bilan de la conquête. Douze baronnies, chacune comprenant un certain nombre de fiefs de chevalerie, furent notamment prévues et instaurées. En 1210, les barons reconnurent Geoffroi comme leur prince (il ne pouvait être question de royaume et le terme de duché fut sans doute jugé trop modeste). En 1212, Geoffroi inféoda Argos et Nauplie, situés au nord-est de la péninsule, à Othon de la Roche, qui était aussi et surtout seigneur d’Athènes et d’Estive (Thèbes). A cette date, les Byzantins ne conservaient plus que le port de Malvoisie (Monenvasia), au sud-est. (…) PHILIPPE CONTAMINE
Polybe et le chevalier de Folard.
Ce n’est pas Polybe qui a annoncé le chevalier de Folard, c’est le chevalier de Folard qui a découvert Polybe au début du XVIIIe siècle, et a trouvé en ses écrits les principes de sa propre réflexion théorique sur l’art de la guerre à une époque où la consécration du fusil comme arme majeure de l’infanterie, et donc de la bataille, devenue temps et lieu d’affrontement de deux lignes minces de fantassins, est lui-même mis en interrogation. Après l’ordonnance de 1703 qui supprime la pique de l’infanterie française, il convient de tirer les leçons tactiques de la bataille de Malplaquet, au cours de laquelle près de trente mille hommes sont mis hors de combat, tués ou blessés, sans qu’il y ait ni vainqueur ou vaincu, ni espace conquis ou perdu, ni même simple avancée ou reculade. Une « tirerie » inutile, juge Maurice de Saxe une vingtaine d’années plus tard. Vingt années pendant lesquelles le chevalier de Folard est allé chercher un autre modèle organique et tactique, plutôt que stratégique, dans la guerre antique : ni la phalange grecque, ni la légion romaine, chacune invincible en son temps, ne se trouvait équipée du feu. Présent dans la guerre timidement depuis la fin du XVe siècle, plus largement dans le cours du XVIe siècle, le feu peut-il vraiment remplacer le fer ? Il semble plutôt conduire à une impasse tactique. La question peut alors se renverser : le fer ne doit-il pas retrouver son rang auprès du feu, afin de résoudre ce blocage ? Telle est bien l’opinion théorique du chevalier de Folard, qui l’expose dans un Traité de la colonne écrit dès 1715. La rencontre entre Polybe et Folard vient juste après, et ne relève pas du hasard. Folard trouve dans Polybe les récits historiques et militaires qui lui permettent de démontrer la supériorité, en leur temps, d’armées qui ne connaissaient que le fer, et il y voit la démonstration de la justesse de ses vues. Il lance ainsi un débat qui a occupé tous les théoriciens de l’art de la guerre au milieu du XVIIIe siècle, jusqu’à ce qu’une nouvelle perspective de caractère stratégique autorisée par la transformation des armes à feu ne vienne en assurer le relais, sinon avec la guerre révolutionnaire, au moins avec Napoléon dont les grandes campagnes européennes enterrent aussi bien Polybe que Folard. (…) JEAN-PIERRE BOIS
Ingres historien militaire ? Quelques aspects du fonds inédit du musée Ingres de Montauban.
Ingres, parmi ceux qui, jusqu’à leur dernier souffle, se dirent « peintres d’histoire » – le titre figure sur son faire-part de décès – est sans doute celui qui a le plus soigneusement évité ce passage obligé, ce Mont-Saint-Bernard que les artistes veulent tous franchir dans la gloire et l’éclat : la bataille. Sous Louis-Philippe, Balzac a bien fait entendre, dans Pierre Grassou, ce cri de triomphe du peintre, qui de médiocre portraitiste devient peintre d’histoire : « Le roi m’a donné une bataille à faire ! » Cri médiéval, qui vaut presque anoblissement pour l’artiste, alors qu’il ne s’agit que de brosser une grande machine pour la Galerie des Batailles du roi citoyen à Versailles.Ingres, mortifié par l’éreintement critique de son grand tableau d’histoire antique à multiples figures, qui n’était que peu militaire malgré la présence d’un préteur romain, de faisceaux de licteurs, d’enseignes et de buccinateurs autour d’une porte fortifiée scrupuleusement reproduite, Le Martyre de Saint Symphorien (Autun, cathédrale Saint-Lazare) laissa, avec rage, prospérer Paul Delaroche, qui à ce même Salon de 1834, triompha avec cette vignette agrandie, L’exécution de Lady Jane Grey (Londres, National Gallery). Ingres n’aimait pas peindre la guerre et abandonna sans états d’âme le terrain de l’histoire militaire et sanglante qu’occupait déjà bien par ailleurs Horace Vernet, qui couvrait d’immenses surfaces pour raconter Bouvines ou Fontenoy. Ingres amoureux de la beauté pure, de l’émotion sensuelle, du sentiment vrai, du corps des femmes, et de son idéal, était aussi étranger à ce qu’est un champ de bataille que Fabrice à Waterloo. Cela ne l’intéressait pas. A Versailles, il laisse son ami Jean Alaux peindre la bataille de Villaviciosa, la Prise de Valenciennes et celle de Denain, pour la plus grande gloire de la France. (…) ADRIEN GOETZ
Le front d’Orient dans la Grande Guerre. Enjeux et stratégies.
En ces années de commémoration du centenaire, il faut bien se rendre à l’évidence : dans le contexte de la Grande Guerre, Salonique n’est qu’un théâtre marginal. La mission de celui-ci se présente sous des traits plutôt modestes : se mettre en situation de s’engager afin de faciliter les opérations des autres fronts. A travers l’ouverture et l’organisation stratégique de ce théâtre, modelées toutes deux au gré des circonstances, c’est le principe même de la conduite de la guerre qui se met en vigueur avec ses multiples prolongements : le jeu complexe des alliances, la difficulté à établir une ligne d’action commune à longue échéance à cause de la diversité des intérêts en jeu, les courants internes de la vie politique et leur impact sur le processus décisionnel, la stratégie périphérique avec l’importance accordée aux fronts secondaires dans le contexte d’un conflit généralisé, l’unité de commandement, bref, des composantes éternelles de toute guerre de coalition. Quelle est la justification de la présence d’un corps expéditionnaire allié à Salonique ? Jean Delmas en détermine successivement plusieurs. La justification initiale est simple : voler au secours des Serbes, dont la situation devient intenable lorsque la Bulgarie entre en guerre en octobre 1915. A la lumière de la défaillance serbe, deux mois plus tard, et devant l’impossibilité d’établir la jonction sur le Haut-Vardar, les avis divergent quant à l’avenir de l’expédition. A Paris, les partisans de la stratégie indirecte se prononcent en faveur du maintien et de l’organisation du dispositif allié dans les environs de Salonique. La valeur principale de cette région, disent-ils, est plutôt celle d’une place forte de défense, permettant d’entreprendre des actions offensives en temps et lieu opportuns. Choix d’autant plus impératif qu’il permet de se mettre à l’abri de tout fléchissement intempestif de la Roumanie et de la Grèce, fournissant à l’adversaire l’occasion de réaliser ses ambitions impérialistes en Orient. On reproche même au gouvernement d’assister inactif à l’anéantissement de la Serbie. Menés par Clemenceau, les « Occidentaux » s’opposent, quant à eux, à tout engagement prématuré, même dans le cas favorable, peu probable pourtant, d’un alignement grec. Faisant l’objet d’attaques de tous les côtés, le gouvernement Viviani est remplacé, fin octobre, par un cabinet Briand, mieux disposé face à un éventuel maintien de l’expédition. (…) YANNIS MOURÉLOS
Tables des matières
- Allocution d’accueil, par Michel ZINK, secrétaire perpétuel de l’AIBL
- « La guerre et les historiens », par M. Trédé, correspondant de de l’AIBL
- « Les orateurs antiques entre guerre et paix », par L. PERNOT, membre de l’AIBL
- « Guerre et philosophie en Grèce ancienne : aux origines de l’art de la guerre », par J. JOUANNA, membre de l’AIBL
- « Du nouveau sur le combat des hoplites. Vraiment ? », par P. DUCREY, associé étranger de l’AIBL
- « L’éphébie athénienne comme préparation à la guerre du IVe au IIe siècle av. J.-C. », par D. KNOEPFLER, associé étranger de l’AIBL
- « L’organisation de la guerre macédonienne : Philippe II et Alexandre », par M. HATZOPOULOS, associé étranger de l’AIBL
- « Payer la guerre en Grèce antique », par O. PICARD, membre de l’AIBL
- « Le feu grégeois, ses vecteurs et ses engins de propulsion », par R. HALLEUX, associé étranger de l’AIBL
- « Alexandre le Grand, modèle et précurseur des croisés ? », par J.-Y. Tilliette, correspodant de l’AIBL
- « La défense de l’Empire romain d’Orient lors de la quatrième croisade », par J.-C. Cheynet
- « Quand la Morée était française : “Faits d’armes et de chevalerie” », par Ph. CONTAMINE, membre de l’AIBL
- « Polybe et le chevalier de Folard », par J.-P. Bois
- « Ingres, historien militaire ? Quelques aspects du fonds inédit du musée Ingres de Montauban », par A. Goetz
- « Le front d’Orient dans la Grande Guerre. Enjeux et stratégies », par Y. Mourélos
- Bilan et conclusions, par Ph. CONTAMINE et J. JOUANNA
Se procurer cet ouvrage
Site : https://www.peeters-leuven.be/Peeters Publishers – Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven, Belgiquetél. 00 32 (0) 16 24 40 00peeters@peeters-leuven.beBureau Paris – 52, Boulevard Saint-Michel, F-75006 Paristél. 01 40 51 89 20